
L’époque moderne
Le Domaine fut acheté en 1870 par un industriel narbonnais, Monsieur Parazols : 173 ha dont 129 de vignes. Il a démoli plusieurs petites masures pour construire les bâtiments actuels et 2 autres qui ont été détruits par des incendies.
Il commença par la belle cave, à l’entrée, lieu où se pratiquait le commerce du vin et qui avait un rôle de représentation. En face il établit le bâtiment dit « la bascule » pour peser les chargements.
On raconte que le maçon qui fit le chantier était Saturnin Margail, homme d’une dextérité exceptionnelle, et dont les ouvriers s’arrêtaient parfois pour le regarder travailler (ce témoignage fut donné par son arrière petite fille, présidente du musée Terrus à Elne).
Ensuite, les bâtiments de l’actuel « Domaine Belric » dans une facture plus modeste :
L’aile qui abrite maintenant les gîtes fut à cette époque le lieu des logements d’ouvriers : 9 familles y logeaient à l’année en plus des journaliers qui venaient offrir leurs bras aux périodes chargées, notamment pour les foins, la taille de la vigne et les vendanges. Cette partie était d’une grande sobriété.
En 1893 sont construites l’autre aile et la tour centrale, dont le rez-de-chaussée est devenu l’actuelle salle de réception. Ce rez-de-chaussée abritait l’écurie avec place pour 22 chevaux dédiés aux travaux des champs. À l’étage supérieur fut aménagée une magnanerie : en 1892 un décret du gouvernement octroya des subventions aux agriculteurs qui relanceraient l’élevage du ver à soie et la construction date donc de l’année suivante. Cette époque a marqué le paysage : il reste encore des vieux mûriers en alignements le long des routes et des chemins. Une grande cheminée à l’étage permettait de garder une douce température pour le développement des cocons.
Au début du XXème siècle, des rizières furent aménagées mais l’activité de la vigne a tout supplanté et les rizières servirent d’herbage pour les chevaux.
En 1930, un grand incendie ravagea cette aile. Toit et plancher disparurent et furent reconstruits. Le bois fut remplacé par le fer, matériau localement extrait près du mont Canigou et d’une qualité exceptionnelle comme en témoignent les nombreux clochers en fer forgé, jamais attaqués par la rouille. Le toit et les plafonds en voutains soutenus par des piliers de fonte particulièrement élégants furent ainsi réalisés avec des charpentes métalliques par des élèves de Gustave Eiffel.
Depuis 1912, le Domaine appartenait à la famille Jonquère d’Oriola, dont faisait partie Pierre Jonquère d’Oriola, cavalier émérite. Dans les années 60, le bien tombe en indivision car son propriétaire Christophe Jonquère d’Oriola décède sans enfants et ses neveux tentent de le gérer et de maintenir l’activité. Il est finalement vendu en 2 lots : l’un en 2000 et l’autre, actuel Domaine Belric, en 2002.

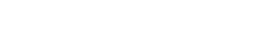






 Agence de digitalisation Newton Concept
Agence de digitalisation Newton Concept